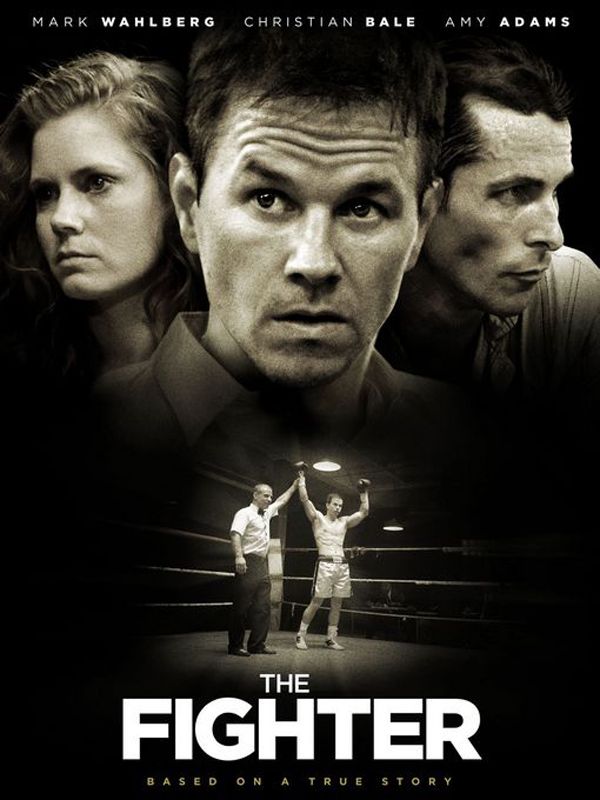Lots of people have asked me about the title of my book. It’s part of Negro slang. When you say you want to go to Fat City, it means you want the good life. I got the idea for the title after seeing a photograph of a tenement in an exhibit in San Francisco. ‘Fat City’ was scrawled in chalk on a wall. The title is ironic: Fat City is a crazy goal no one is ever going to reach. Léonard Gardner auteur du roman et scénariste du film.
Fat City, c’est la grosse ville pleine de fric et de lumière. Un genre Las Vegas avec crédit illimité, la ville rêvée de ceux qui n’ont rien. « Je vivrai un jour à Fat city », promettent tous les mendiants des rues américaines. C’est le titre du film, choisi par dérision pour décrire la vie particulièrement sinistre de deux boxeurs minables. C’est pas le film le plus gai du monde, mais attention il y a du très rare, du précieux dans l’histoire.
John Huston, metteur en scène mythique d’Hollywood, boxe plutôt chez les lourds. « Le Faucon Maltais 1941 », « Key Largo 1948 », « Le Trésor de la Sierra Madre 1948 », « Quand la ville dort 1950 »… Des classiques « Big size » du cinéma américain. Pas d’incursion dans l’intime, pas de combat chez les « plumes », jusqu’à « Fat City », un film improbable qui aurait pu être tourné par la nouvelle vague, par un Cassavetes. Une parenthèse dans la carrière d’un réalisateur qui a connu l’âge d’or, recueilli dans ses « Misfits » les derniers souffles de Clark Gable et de Marilyn Monroe et qui en 1972, n’avait plus rien à démontrer à personne.
En bref, c’est l’amitié entre un vieux boxeur qui a connu une petite gloire régionale et un jeune brave type, à qui on fait croire qu’il a les poings de Mohamed Clay et qui se fait mettre KO à chaque combat qu’il doit gagner.
Quand on affronte un boxeur doté d’un bon crochet du gauche, tôt ou tard, il vous descendra. II sortira son gauche de nulle part et il s’écrasera comme une brique. C’est la vie qui possède le meilleur crochet du gauche, même si un tas de gens croient qu’il s’agit de Charley White de Chicago. Hemingway
Le crochet du gauche de la vie, c’est le sujet du film.
Le message de Huston, qui a pratiqué lui aussi dans sa jeunesse, est que la plupart des hommes naissent KO debout. Parmi eux, les plus nombreux attendent de tomber, les autres boxent. Les personnages de « Fat City » savent qu’ils ne seront jamais champions du monde. Leur vie est vide et leur seule certitude est qu’elle tiendra jusqu’au bout ses promesses de désillusion. Mais ils se battent, c’est la différence entre eux et les spectateurs des bords du ring. Vous verrez les combats du film, les coups sont lents, fatigués, les corps souffrent, personne n’a le punch nécessaire, on s’accroche beaucoup, aux bras, aux cordes, à l’espérance du gong. Les boxeurs ne mettent aucune passion dans l’affaire, ils n’insultent pas leur adversaire, le regardent à peine, boxent et s’en vont. On est au rendez-vous des princes de la loose, ceux qui passent leur temps à perdre et à rater. Et qui s’entêtent. Les grands flambeurs qui ne jouent pas pour gagner, mais pour sortir du troupeau des hommes domestiqués, soumis au programme commun de vie médiocre, d’extinction en bougie minuscule. Les boxeurs sont des torches, ils s’allument haut et se consument vite. Ce sont toujours des hommes brillants, même ceux qui n’ont aucun talent.
À Fat city, on ne livre pas un match contre quelqu’un, c’est clair. On boxe contre les destins, comme des petits capitaine Achab en shorts avec des harpons en forme de gant. D’ailleurs John Huston a tourné « Moby Dick » (1956) avec Gregory Peck et Orson Welles. Pas un hasard. On ne boxe pas contre son prochain, on ne chasse pas une baleine, on se mesure à la fatalité. Inutile ? Certainement mais digne. Il est question de dignité dans ce sport. On la retrouve dans le face à face, dans le combat à arme égale alors que le destin nous écrase sans aucun mérite.
Quand le capitaine du « Pequod » s’adresse aux Dieux qui l’ignorent et passent leur chemin indifférents comme la baleine blanche, il les insulte et les poursuit. Il sait que la partie est jouée d’avance, mais aussi que l’homme a une arme absolue contre les forces qui le dépassent, c’est qu’en l’écrasant, les Dieux descendent à sa hauteur.
Me faire fléchir ? Ils ne peuvent pas me faire fléchir, sans fléchir eux mêmes. L’homme les tient là.
Un boxeur doit lire Melville pour améliorer son crochet du gauche.
En résumé, « Fat city » est le plus grand film de boxe jamais réalisé. Mais c’est pour les gourmets et les attentifs. C’est un peu long, il se passe pas grand-chose. Il faut attendre pour que le goût saisisse et infuse comme un grand vin.
Une question pour finir : et si la dernière séquence : silence de 3 minutes, dans un bar, plan fixe sur deux hommes qui n’ont plus rien à dire, était la plus belle fin de l’histoire du cinéma ?
Antoine Sénanque