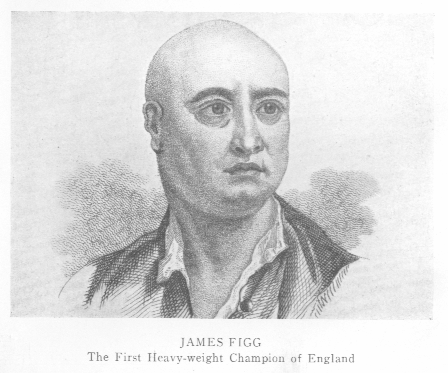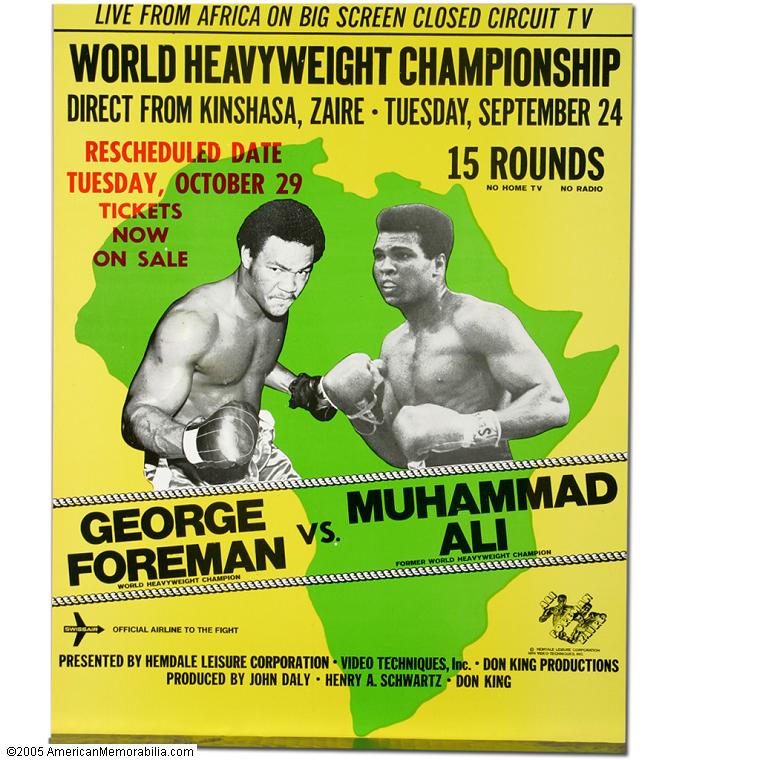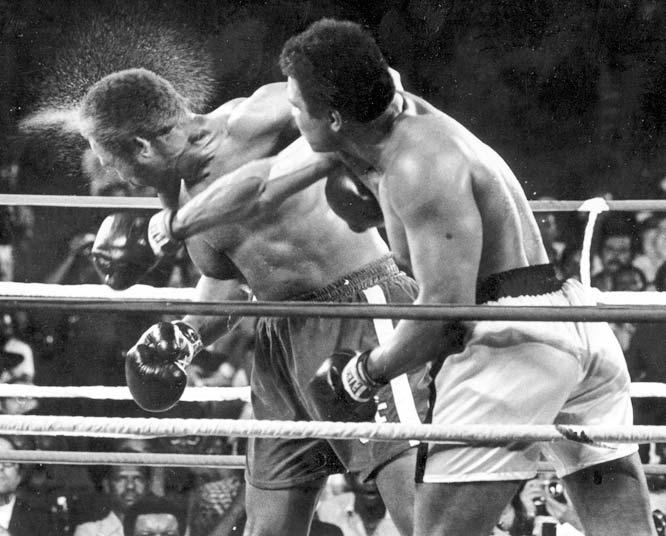Les 45 000 spectateurs du stade Demba Diop de Dakar ont beau hurler à s’en casser la voix, danser et répéter les chorégraphies de leurs champions, au milieu de l’arène, les deux lutteurs sont désormais seuls sur le sable.
Comme chaque 1er janvier, le titre de « Roi des Arènes » est en jeu. C’est le moment de vérité, celui dont rêve tous ces jeunes sénégalais qui suent à longueur de journée sur les plages du littoral. « C’est une gloire sénégalaise et ça leur suffit. Les Jeux olympiques sont beaucoup moins prestigieux. Et puis, là-bas, ils ne peuvent pas combattre avec leur marabout », explique l’écrivain et photographe Philippe Bordas, auteur de L’Afrique à poings nus.
Les deux lutteurs sont seuls sur le sable, mais ils ne quittent pas des yeux leur préparateur mystique. Pendant les heures qui ont précédé, ils ont suivi à la lettre les recommandations des marabouts. Gris-gris, potions, danse au son des tambours, tout a été fait pour mettre le maximum de chances de leur côté. « Un lutteur qui considère que sa préparation mystique a été bâclée risque de se présenter battu d’avance sur le sable », précise Philippe Bordas. Les anciens prétendent que la lutte est avant tout un combat de marabouts. Et que les lutteurs ne sont que des instruments par lesquels s’expriment des forces qui les dépassent.
La lutte sénégalaise puise aux racines de la tradition. Les hommes s’y adonnaient après la saison des pluies pour prouver leur valeur. Et désigner le champion du village. Pour Philippe Bordas : « La lutte sénégalaise est presque demeurée étanche à la colonisation ». Presque, parce que dans les années 1920 ou 1930, un Français, propriétaire du cinéma El Malik à Dakar, aurait organisé les premiers affrontements de lutte avec frappe, ajoutant les coups de poings aux techniques de saisies et de projections déjà présentes dans la lutte traditionnelle. Pour l’emporter, le lutteur doit faire tomber son adversaire sur le dos, les fesses, les mains et les genoux en même temps, ou le faire chuter en l’expulsant du cercle. « Sans gants ni protège-dent, car ce sont des hommes », précise un habitué des arènes.
« Les lutteurs (restent) enracinés dans leur terre et ne rêvent d’aucune Amérique », écrit Philippe Bordas. « Ils vivent pour une gloire de terroir : pour devenir le champion du village, du quartier ou de la région. » Ce jeune lutteur de Pikine, à Dakar, ne voit pas les choses autrement : « Plutôt que de prendre la mer, nous restons au Sénégal et nous nous battons pour trouver ici ce que d’autres cherchent là-bas ». Il faut dire que depuis le début des années 1990 et l’arrivée des sponsors, la lutte a pris une autre dimension. C’est le sport le plus pratiqué du Sénégal et le mieux payé d’Afrique. Les cachets des géants peuvent friser les 150 000 euros. Des chiffres spectaculaires qui ne concernent qu’une poignée de stars surpayées mais qui nourrissent les espoirs les plus fous de milliers de lutteurs en herbe. Dans les faits, ils sont peu nombreux à gagner leur vie en luttant.
Malgré tout, les lutteurs portent beau. « Des corps pleins, reposés, choyés », évoque Philippe Bordas. L’entraînement sur la plage, les combats en plein air, c’est bon pour la santé. Et pour le moral. Seuls sur le sable, les deux hommes sourient. Ils sont prêts à en découdre. La lutte préserve certes des valeurs ancestrales, mais elle reste étroitement liée aux mouvements sociaux ou générationnels. Dans la seconde moitié des années 1990, Mouhamed Ndao, Tyson pour les intimes, allait au combat drapé dans un drapeau américain. Tyson était bien plus qu’un champion. C’était un pionnier. Un self made man. Le porte-drapeau d’une génération désenchantée. Une génération qui avait entrepris de se débrouiller sans rien attendre de l’État ou des élites corrompues, d’envoyer balader la gérontocratie tout en affirmant son individualisme. La génération Boul Fallé. « Boul Fallé en wolof, ça veut dire se foutre de tout et tracer sa route. C’est un terme emprunté à une chanson populaire du groupe de rap PBS – Positive Black Soul », explique Rama Thiaw qui a réalisé le documentaire Boul Fallé, la voie de la lutte. « Dans les années 1990, les jeunes ont refusé le modèle français et la main de la France sur les affaires nationales. Il s’agissait alors de savoir qui nous étions. La lutte, notre sport national, oublié après l’indépendance, a eu un rôle important dans cette quête. Elle a aussi permis de sortir des préjugés : les jeunes des banlieues de Dakar en avaient marre d’être traités de bandits », ajoute la cinéaste. Pour elle, « Boul Fallé est un mode de narration propre à cette jeunesse qui s’est matérialisé dans la lutte et le hip hop ». Les lutteurs en avaient aussi ras le bol d’être les vaches à lait des promoteurs. Tyson a été le premier à négocier lui-même ses contrats, à revendiquer une pratique moderne de la lutte et un style de vie émancipé des anciens. Il a modernisé la lutte en y injectant l’esprit Boul Fallé. « Il a ouvert la voie de l’autonomie et des rêves », pose Rama Thiaw.
Cela dit, Tyson n’a pas jeté le bébé avec l’eau du bain. Quand il tombait le drapeau américain, le champion se couvrait de gris-gris et payait son dû en gestes symboliques et rituels. La tradition est protéiforme. Elle s’accommode de tout. Elle se réinvente en permanence. « Le sport est pratiqué par des hommes modernes, mais la tradition doit demeurer », résume Tyson.
Les deux hommes sont seuls sur le sable. Le public bout d’impatience. Au premier coup de sifflet, c’est la délivrance. Les deux hommes s’empoignent. Peu importe l’issue du combat, l’enjeu est bien supérieur, résumé par la voix off qui ponctue le documentaire de Rama Thiaw : « Redevenir ce que nous sommes, de nobles guerriers ».
NZ
Article initialement publié dans le magazine Negus