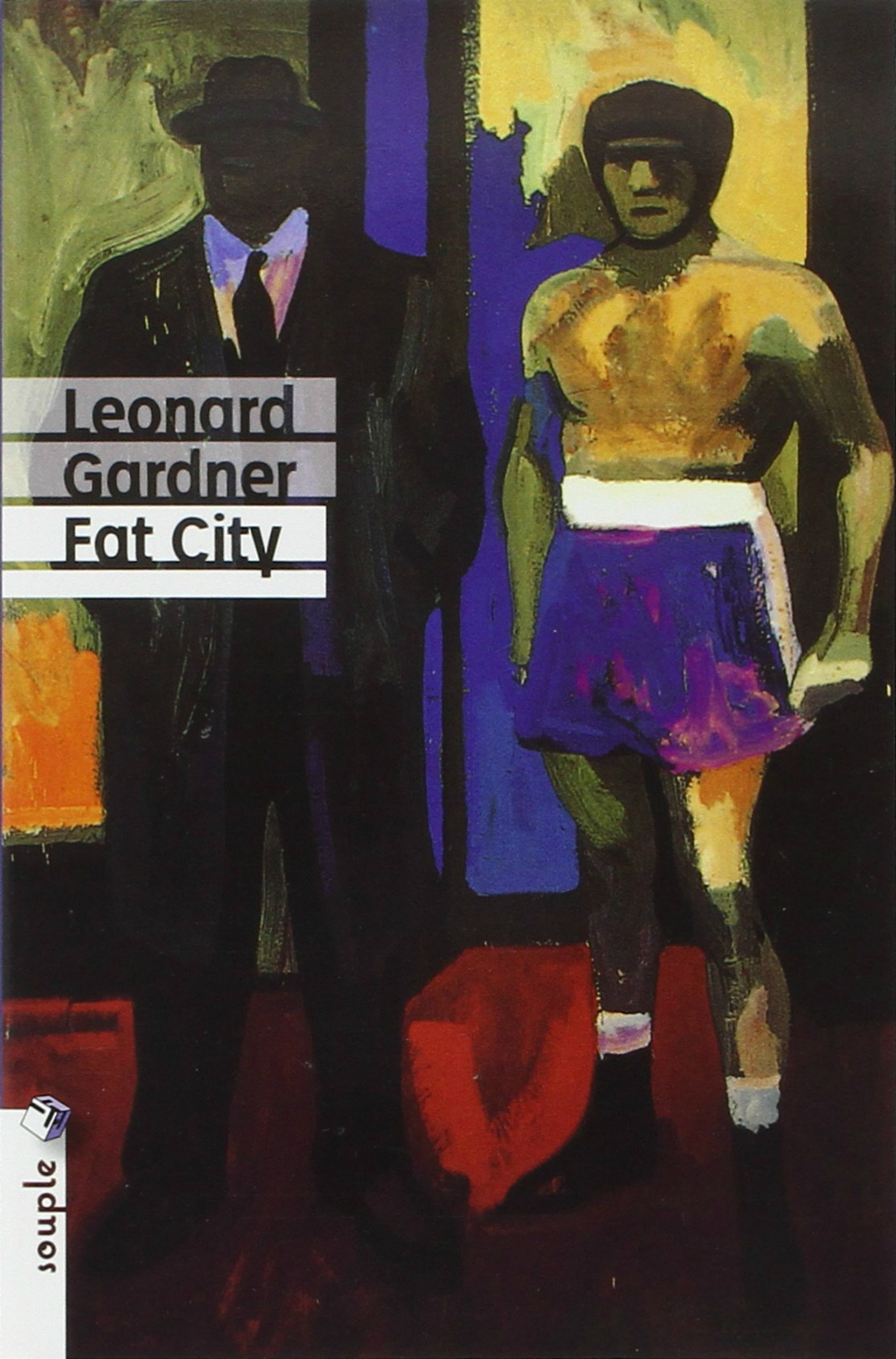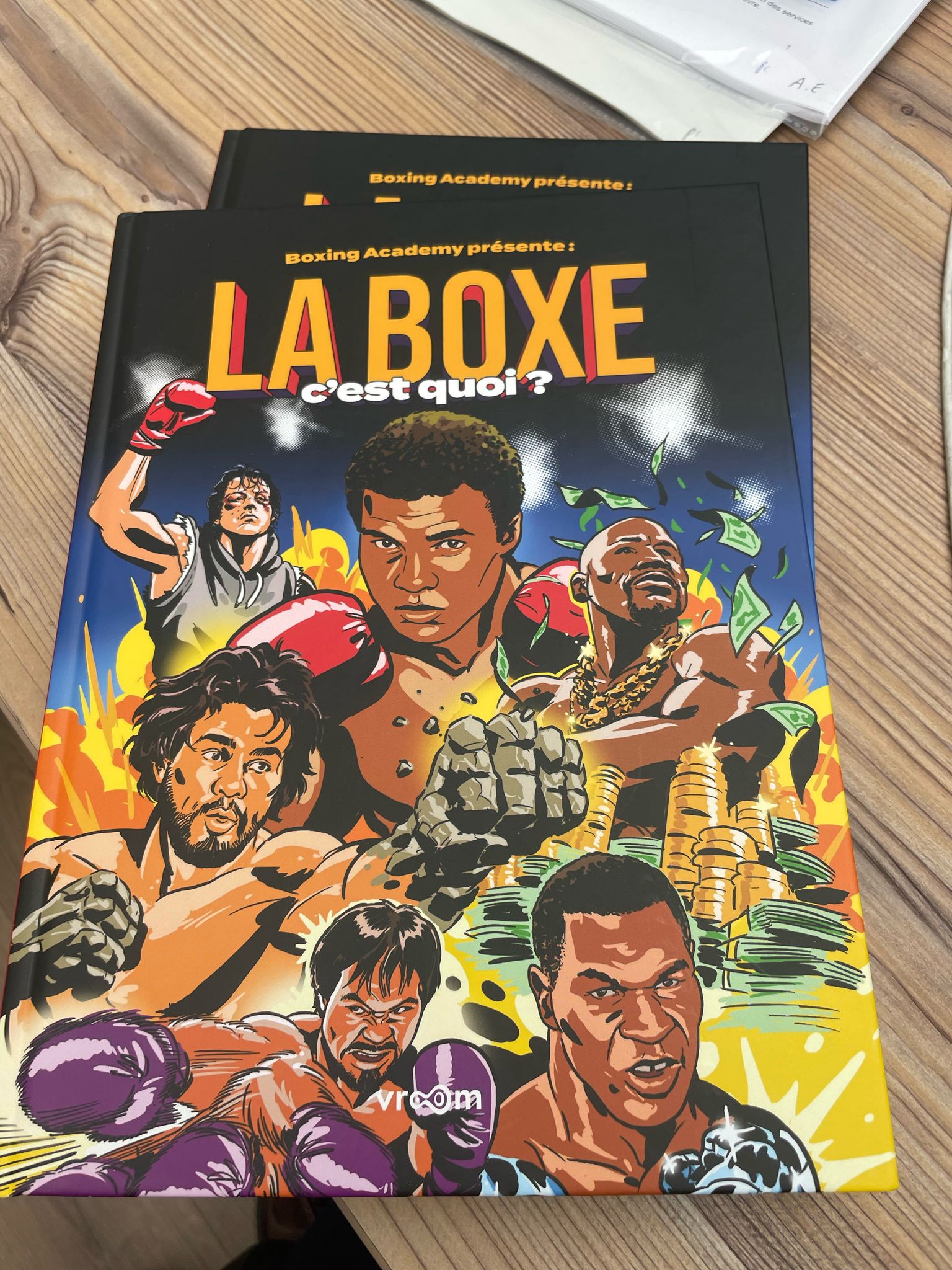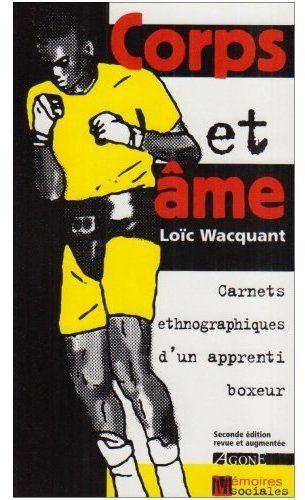Leonard Gardner a écrit un seul et unique roman, Fat City, paru en 1969 et récompensé du National Book Award. Puis plus rien. Car « c’était la seule histoire (qu’il avait) à raconter ». La question lui a été posée un paquet de fois. Assez pour qu’il démontre un certain sens de la formule : « Dans la vie, on ne reste parfois champion du monde que le temps d’un combat ».
S’il n’a raconté que cette histoire de boxe, c’est sans doute parce qu’il l’a vécu dans sa chair. Leonard Gardner a grandi à Stockton, Californie, l’une des villes les plus pauvres des Etats-Unis, la toile de fond de son roman. Elle a déposé le bilan en 2012. La boxe y est très populaire. Le genre d’endroit où « il y a toujours un jeune garçon pour se battre ». Gardner s’est battu lui aussi. Sept combats amateurs pour un nez cassé et une retraite anticipée à 24 ans. Il a connu cette boxe des bas-fonds où le courage prime sur la performance. Où l’on persévère malgré les coups et l’absence de talent.
Il y a fort à parier qu’il a croisé ses personnages dans l’une des salles poisseuses de Stockton : Billy Tully, la gloire locale sur le retour, Ernie Munger, le jeune espoir partagé entre ses rêves de grandeur et sa femme en cloque, et même Arcadio Lucero, le Mexicain qui boxe malgré la coulante.
Ces gars-là ne jurent que par Fat City. Fat City, c’est aussi le titre résolument ironique choisi par Gardner et qui désigne la belle vie en argot. Ils ne l’atteindront jamais, cela va de soi. Fat City est un livre noir. Joyce Carol Oates y voyait les dessous du rêve américain où des hommes avec un talent minimal pour un sport dangereux sont engagés pour se battre les uns les autres contre des sommes pitoyables.
La réalité est âpre, dure à encaisser. Comme un crochet du gauche. Les protagonistes du livre refusent d’admettre qu’ils resteront à l’arrière-plan, qu’ils ne réussiront jamais. Sans quoi, ils ne pourraient affronter ce qui les attend : les rudes batailles du ring et, un jour ou l’autre, le KO dont Billy Tully relève laconiquement tous les synonymes dans la presse : « Démoli, gelé, nettoyé, endormi, embaumé, liquidé, culbuté ». Un programme réjouissant qui lui vaut d’admettre que son sport est l’apanage des fous.
Il y a de la folie, oui. Mais aussi de la dignité. Antoine Sénanque écrivait ici à propos de l’adaptation réalisée avec brio par John Huston en 1972 :
« On est au rendez-vous des princes de la lose, ceux qui passent leur temps à perdre et à rater. Et qui s’entêtent. Les grands flambeurs qui ne jouent pas pour gagner, mais pour sortir du troupeau des hommes domestiqués, soumis au programme commun de vie médiocre, d’extinction en bougie minuscule. Les boxeurs sont des torches, ils s’allument haut et se consument vite. Ce sont toujours des hommes brillants, même ceux qui n’ont aucun talent. »
Voilà pourquoi, quand il termine son premier entraînement à la salle du Lido, Ernie « meurtri, épuisé et heureux, avait le sentiment de se trouver enfin parmi de vrais hommes ».
Les autres font peine à voir :
« Une fantasmagorie de visages épuisés, mutilés, de joues barrées de cicatrices, de nez tordus, grêlés, écrasés et bouffis, de bouches édentées, de chicots noircis, de gencives désertées, de barbes hirsutes, de lèvres pendantes, d’oreilles en chou-fleur, de plaies, de croûtes, de traînées de jus de tabac, d’épaules affaissées, d’arcades sourcilières fendues, d’yeux las, désespérés, hagards… »
La désolante réalité de la défaite ne se tapit pas sur le ring mais parmi ces armées de journaliers qui reprennent chaque jour leur travail inhumain contre quelques piécettes. Voilà les vrais condamnés, les damnés de la terre. Pas une seule lueur d’espoir au fond de leurs yeux. Aucun lucky punch pour les tirer de là. Tully en fait l’amer constat, cassé en deux par une journée de travail aux champs : « Sa vie, déjà, ne lui appartenait plus. Elle s’engloutissait, captive, confondue dans le flot de toutes ces vies perdues à gratter aveuglément la surface de la terre ».
Ernie en remet une couche : « N’importe quoi vaut mieux que ce qu’on fait ici ». N’importe quoi plutôt que de se laisser écraser par la fatalité. Même si le combat pour retrouver la forme est perdu d’avance. Même s’il s’avère chaque jour plus rude de maintenir en vie cette petite flamme qui réchauffe le cœur des boxeurs, même médiocres. Quand celle-ci s’éteint, alors là oui, un homme est fini.
Cette flamme, il faut donc la faire durer au maximum car « quand tu comprends ce que tu as perdu, il est déjà trop tard ».
Peu importe alors que Billy, Ernie et les autres boxent comme si le but n’avait pas été de vaincre mais de tenir. Tenir le choc, c’est toujours ça de gagné.
Lire aussi :
– Sur Fat City de John Huston par Antoine Sénanque.
– « Winners take nothing » de John Huston.
– Le K-O littéraire de Leonard Gardner par Samuel Blumenfeld sur le site du Monde.
NZ