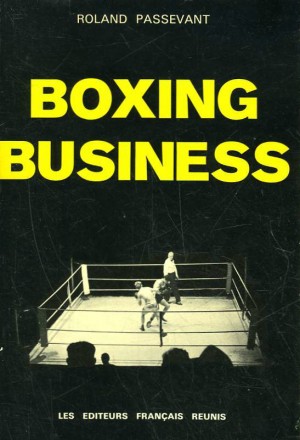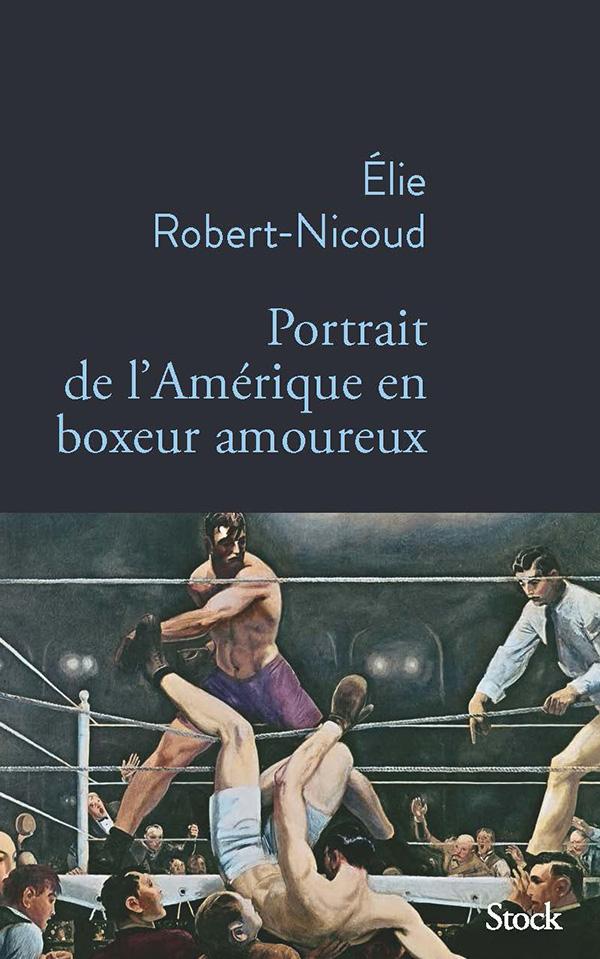Fausse patte du dimanche, retiré des rings depuis belle lurette, ancien welters flirtant désormais avec la limite des lourds, je me demande souvent quel est le bilan de ces années boxe. Les aventures entre quatre cordes, les charges d’adrénaline, les bons souvenirs font-ils le poids face aux bleus au corps et à l’âme ? Chacun fait ses propres comptes d’apothicaire.
Reste que la boxe m’a donné le goût des grandes entreprises. La dernière en date ? Relire toute l’œuvre d’Ernest « Papa » Hemingway. Un type qui considérait la vie comme un gigantesque ring.
« Quand on affronte un boxeur doté d’un bon crochet du gauche, tôt ou tard, il vous descendra. II sortira son gauche de nulle part et il s’écrasera comme une brique. C’est la vie qui possède le meilleur crochet du gauche, même si un tas de gens croient qu’il s’agit de Charley White de Chicago. »
Dans Le courant, une nouvelle de jeunesse écrite en 1921 mais seulement publiée en 1985, Hemingway donne déjà dans le noble art. Avec une attention toute particulière pour « la difficulté à vaincre ».
Stuyvesant Byng est un jeune homme qui a tout pour lui : beau comme un dieu, les poches gonflées de dollars et, apparemment, un certain talent pour l’exercice physique. Il semble même doué d’un naturel aimant. En témoigne son penchant pour Dorothy, une belle rouquine dont on comprend entre les lignes qu’elle lui rend la pareille. Alors, bague au doigt ? Stuy est bien décidé à faire sa demande.
La jeune femme en question, échaudée par sa réputation de coureur pusillanime, pose une condition : que cet éternel second démontre sa capacité à être un champion.
En bonne compagnie – un ami cher et une bouteille de whisky -, Stuy évalue les possibilités. La pêche à la mouche ? Il est l’as de la région mais « elle ne trouverait pas ça suffisant ». Le tennis ? Aucune chance. Le golf ? Trop tard. Le polo ? Aucune compétition avant un an. La boxe alors ?
Dawson, le coach du coin, prétend que « si Mr. Byng voulait devenir professionnel, il n’y aurait pas aujourd’hui un seul homme sur le ring capable de le battre à soixante-dix kilos ». Sauf que Stuy a raccroché. Il n’aime pas la boxe, il déteste encaisser et a toujours des sueurs froides au moment de grimper sur le ring. Il faut croire que l’amour fait parfois des miracles.
Ce sera donc la boxe. Cornaqué par le vieux Dawson et l’ami Sam, le revenant aligne les victoires et les KO grâce à « un gauche un tantinet plus rapide que tout ce qu’on avait pu voir auparavant dans la catégorie poids moyens, et un droit qui n’aurait pas pu être plus efficace s’il avait été lesté avec un gant garni de béton ».
Jusqu’au combat final, à la Nouvelle Orléans, celui qui doit valider son statut de champion et signer du même coup la fin de sa carrière. Le dernier obstacle se nomme McGibbons, un authentique irlandais « trapu avec un faciès simiesque et de longs bras de gorille ».
Le prétexte à un face à face vieux comme le monde entre la jolie petite gueule de la haute et le monstre des bas-fonds. Avec, en sous-main, le genre d’arrangement qui fait le sel de la boxe : toute la bourse au vainqueur.
Sous les yeux de la belle, Stuy s’impose à la faveur d’une ruse que n’aurait pas renié le grand Mohamed Ali. Après s’être rudement fait amocher, il feint d’être au bord du KO et surprend le Gorille d’un droit qui l’envoie au tapis pour le compte : « L’arbitre compta dix, mais il aurait pu compter jusqu’à cent ».
Et la belle de se jeter dans les bras du vainqueur, « si beau et si laid avec (son) visage tuméfié et en sang » avant de s’assurer qu’il ne boxera plus jamais.
« Ne t’inquiète pas, chérie, dit-il. Ne t’en fais pas. »
NZ